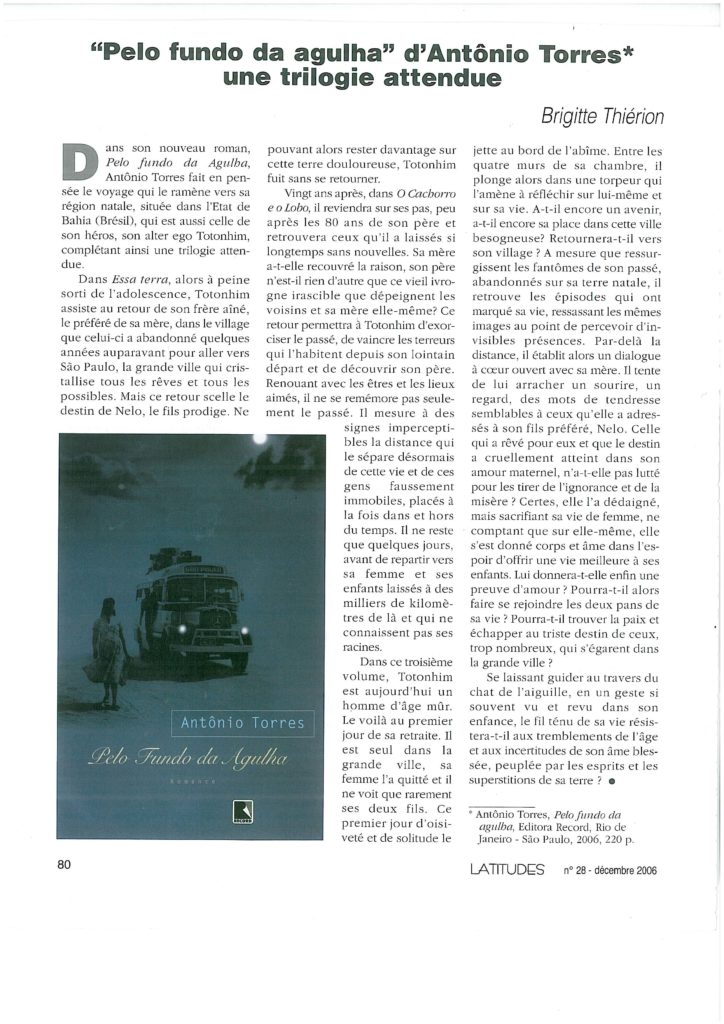À propos de “Mon Cher Caniballe” Correio Braziliense – 18 de junho de 2000
Milieu, fim et commencement
Hélio Meira de Sá
Au début, étaient les bois, les montagnes, les fleuves et les Indiens. La vision de paradis qui paraît en estampe sur la couvertyure du livre de Antônio Torres, Mon cher Cannibal anticipe un peu ce que le lecteur va trouver. Dans l’illustration de l’artiste graphique, Elcio Noguchi, un Indien, droit comme un I, se dresse en haut do Corcovado, brandissant un arc et visant, avec sa flèche, un paysage ou l’on découvre la Forêt Atlantique et le Pão de Açúcar, sans son invétiable tramways, et encore immaculée, la baie de Guanabara.
Le contraste entre ce paradis perdu, habité depuis les tous premiers temps par les Indiens Tamoios et le Rio de Janeiro actuel est l’axe central de ce récit. L’Indien Cunhambebe, chef de la tribu antropophage des tupinambás, surgit comme le protagoniste et le symbole d’un Brésil hégémoniquement indigène.
L’auteur se sert du langage de fiction comme instrument pour raconter, d’un côté, la période coloniale du XVI ème siècle et, surtout, la trempe guerrière de Cunhambebe “le cher cannibale” et son peuple. De l’autre, le narrateur, probable alter-ego de Antônio Torres, se penche en un exercice de métalangage, sur des livres crasseux, des vieux livres oubliés, dans un effort de reconstitution de “dates exactes, de noms corrects, de mythes et de fables” quelque peu machadien. Le distancement temporel du narrateur crée des situations optimales permettant d’interférer, dans les faits racontés, au moyen de commentaires enjoués ou de simulations de dialogues, avec les personnages dont il fait le portrait.
Le mot-clef employé tout au long du livre est “présumé”, qui alerte le lecteur sur l’imprécision et la subjectivité des récits choisis comme support documentaire. Ce sont des oeuvres de voyageurs écrivains qui vinrent ici, comme le français Henri Thévet ou le missionnaire calviniste, lui aussi français, Jean de Léry, révélant naturellement une option de l’auteur pour la lecture froncophone des épisodes. Il y a aussi l’omniprésent allemand Hans Staden, prisonniers des Indiens Tupinambas pendant neuf mois, qui heureusement a fuit les supplices des cannibales, et a pu léguer les premiers témoignages, écrits et illustrés, sur Cunhambebe. En effet, les témoignages avaient pour objectifs d’éveiller l’imaginaire européen sur une réalité lointaine, exotique et sauvage, utilisant, assez souvent, des moyens hyperboliques et l’invraisemblance.
La narration se structure en trois parties entrelacées et complémentaires. La première – le cannibale et les chrétiens – tourne autour de l’installation de la colonie française de Villegagnon, la France Antartique (1555-1559) dans la baie de Guanabara, un refuge calviniste en terres tupinambas. Talentueux conteur d’histoires, Antônio Torres montre les bonnes relations que Cunhambebe entretenait avec les Français (calvinistes, corsaires ou contrebandiers). Notre cannibale arriva à être reçu avec les honneurs de chef d’Etat dans l’enclave française, passant en revenue les soldats royalement alignés. Au contraire du “bon sauvage idyllique”, il se glorifiait du sang ennemi qui coulait dans ses veines, après avoir avalé un grand nombre d’ennemis, dont beaucoup étaient portugais et qu’il traitait de menteurs, traîtres et couards. Par ailleurs, un autre indice de ses préférences, l’auteur présente les Portugais hostiles, comme les jésuites José Anchieta et Manoel da Nóbrega qui avaient pour mission d’évangéliser les Indiens mais qui insidieusement portaient la croix dans uma mains et les armes dans l’autre. Réfractaires aux Portugais, les diverses tribus de la région, fondèrent une confédération des Tamoios pour les combattre, choisissant Cunhambebe comme chef suprême.
Déjà la seconde partie – No princípio Deus se chamava Monam – réunit la religion, les mythes et les croyances des Tupinambas. La mythologie payenne des Indiens Canibales fut supposément transmise par Cunhambebe au frère André Thevet. En accord avec la version de Thévet, les Tupinambas croyaient en l’existence d’un Dieu appelé Monam qui créa le ciel, la Terre et tout ce qui existait. Dans cette cosmogonie, il y a des références à un déluge ou à deux frères qui représentent le bien et le mal. Sous cet aspect; la ressemblance entre les passages bibliques et les mythes indiens est incroyable, surtout si l’on prend en compte que les Indiens vivaient isolés et qu’ils n’avaient pas encore eu de contacts avec les Blancs.
Dans la dernière partie, une espèce de making of du livre, le narrateur qui habite notre quartier contemporain de Copacabana, se rend à la ville de Angra dos Reis à la recherche de documents et des anciennes pistes des Indiens. C’est là, cepedant, que la prose de l’auteur de Essa Terra atteint as plénitude. Au milieu de souvenirs suscités par ses recherches, il observe un Rio chaotique, désordonné, installé sur le territoire qui fut autrefois des Tamoios, ville dont l’histoire de la construction et de développement a été réalisée au prix de l’exploitation et de la soumission des noirs et des indiens. Dans son voyage, il constate, in loco, que les descendants du guerrier Cunhambebe sont nichés dans une réserve aux environs de Angra dos Reis, chaussant de stong, formant une confédération des vaincus.
En s’essayant au genre de la fiction historique avec Mon cher Cannibale, Antônio Torres surprend ses lecteurs et ouvre de nouvelles voies pour son oeuvre. Il ne maintient fidèle, cepedant, à son stle de construction d’intrigues avec commencement, milieu et fin, pas nécessairement dans cet ordre, mais dans un récit déconcertant et sinueux. Son langage coule avec des phrases courtes et des mots précis, recourant fréquemment dans ce livre, à des expressions populaires qui, au lieu d’appauvrir le texte, contribuent à rendre le récit nplus alerte. Pour ce faire, il met à profit des citations reprises à d’autres écrivains ou même dans des chansons populaires. L’idée récurrente de la cannibalisation – l’anthropophagie explicite – imprime une légèreté ludique à son style. Au moment où l’on commémore les 500 ans de la découverte du Brésil, et où les survivants Indiens sont rejetés des manifestations officielles, Antônio Torres offre au lecteur le plaisir d’une lecture agréable et d’un sincère hommage à nos ancêtres.
Hélio Meira de Sá est diplômé en lettres de l’Université de Brasília.
L’Ecrivain des âmes “retirantes”*
Le bahianais Antônio Torres est, sans crainte de commettre une impropriété, l’un des grands talents de la littérature brésilienne contemporaine. Son oeuvre est l’écho d’un sertão* bahianais lointains et mythiqie. Il est bon de ne pas lui faire le crédit d’une teinte de littérature régionaliste.
Au contraire, en se plongeant dans des décors et des situations qui lui sont familières l’écrivain ne le fait pas avec le seul objectif de représenter la misère de la région, les conditions infrahumaines du Brésil rural, mais pour exposer comme destin inévitable, les misères de l’âme humaine. Ainsi en émigrant vers les grendes villes, à la recherche de meilleures conditions de vie, le nordestin se heurte aux écrasantes frustrations urbaines.
C’est justement sur ce point que l’oeuvre de Antônio Torres se différencie de celle des écrivains régionalistes comme Graciliano Ramos, José Américo de Almeida, José Lins do Rego et tant d’autres. Pour eux le retirante du sertão berçait sa longue marche de l’espoir d’une vie meilleure. Il y avait un désespoir qui se nourrissait de l’espoir. Ce n’est pas par hasard que Antônio Torres affirma dans une entrevue que “ce n’est pas la sécheresse qui expulse, mais la civilisation qui attire”. Elle attire, puis elle trahit. Ce drame semble être celui de Nelo, personnage de Essa Terra (Cette terre), publié en 197: il laisse as ville de Junco, dans l’intérieur de l’Etat de Bahia pour aller à São Paulo, et revient pour se perndre dans les cordes d’un filet.
Ecrivain ingénieux, son stle est marqué par un récit entrecoupé, formés de fragments incogérents, morceaux de mosaïque. C’est au lecteur que revient la tâche de réordonner le tout de façon harmonieuse et logique. L’important, dans sa vision d’écriture littéraire, n’est pas de créer une histoire linéaire, comme il faut, avec un commencement, un milieu et une fin, mais une histoire “qui, dans cette fin, doit se terminer avec un commencement, un milieu et une fin”.
Journaliste et rédacteur publicitaire, ses contes et ses nouvelles ont été traduits dans divers pays. Essa Terra, son oeuvre la plus connue, a été traduite en allemand, français, anglais et hébreux.
Il débuta en 1972 avec Um cão uivando para a lua, qui réunit les éloges de la critique et un prix pour un auteur débutant. Hardi, à la recherche permanente de nouvelles formes de récit, le lancement de Meu querido Canibal ouvre de nouvelles perspectives thématiques, peut-être déjà annoncées dans Um táxi para Viena de Áustria, lancé en 1991. (HMS)
* retirante: nom que l’on donne aux paysans de l’intérieur nord-est du Brésil qui, pour fuir la sécheresse, quittent leur région pour aller chercher du travail ailleurs, surtour dans les villes.
* sertão: nom donné à l’intérieur sec du Brésil, notamment dans le nordeste du Brésil, souvent ravagé par de longue période de sécheresse.
Traduction: Solange Parvaux